Chambre d’agriculture
Vin, coronavirus, ZNT… Le point sur la dernière session
Jeudi 20 février s’est tenue la première session de l’année 2020 de la Chambre d’agriculture de l’Yonne, en présence d’Henri Prévost, Préfet du département. La viticulture a été abordée : influence du Brexit et de la taxe américaine sur le marché icaunais, révision de l’AOC Bourgogne, climat… Un point sur le contexte mondial fragilisé par le coronavirus et les ZNT a été fait.
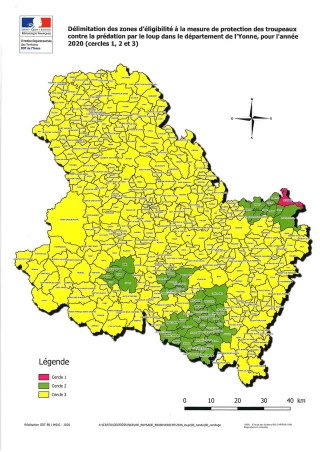
«Les températures relativement douces de l’hiver pourraient provoquer un débourrement précoce qui rendrait les vignes davantage vulnérables aux gelées printanières», indique Arnaud Delestre, président de la Chambre d’agriculture de l’Yonne lors de la session du 20 février.
Si ce dernier assure «qu’il est trop tôt pour prédire ce qu’il en sera réellement», il tient à rappeler que «la vendange icaunaise 2019 s’est avérée inférieure en volume à ce qui pouvait être attendu en début d’été, la sécheresse d’août ayant fortement impacté les rendements». La production 2019 a connu une baisse de 40% par rapport à 2018 et de 11% sur la moyenne des cinq dernières années.
En ce qui concerne le marché du vin icaunais à l’étranger, en particulier le Chablis, le Brexit et la taxe Trump pourraient avoir une influence importante. Pour le premier, «il est probable qu’un accord de libre-échange soit un jour négocié, ce qui fluidifierait les échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne et sécuriserait les ventes de Chablis», développe Arnaud Delestre. Quant au second, «une taxe de 25% est appliquée aux vins français en règlement d’un litige avec Airbus, jugé à l’OMC. Il semblerait que la filière commerciale s’adapte en rognant sur ses marges, si bien qu’actuellement, les volumes ne semblent pas significativement impactés», poursuit-il. Aussi, la taxe Trump pourrait être redéfinie dans son taux comme dans son étendue et concerner les vins effervescents, impactant ainsi les crémants.
Le coronavirus fragilise le contexte mondial
Plus tôt lors de la session, Arnaud Delestre a commencé par parler du contexte mondial. «Alors que l’économie fonctionne avec des perspectives de ralentissement auxquelles s’ajoutent en toile de fond la guerre commerciale sino-américaine et le Brexit, les échanges sont marqués au moins conjoncturellement par l’épidémie de coronavirus qui rejaillit sur les marchés agricoles, tant sur le porc que le colza. Ainsi, l’anticipation d’une épidémie a induit une baisse des cours du blé, traduisant en cela la crainte d’une baisse de la demande mondiale et notamment chinoise», continue le président de la Chambre d’agriculture de l’Yonne. «Le colza s’est replié, également et indirectement impacté par la crainte de l’épidémie de coronavirus qui a entraîné une chute des cours du soja dont l’huile est achetée en volume conséquent par la Chine». Un phénomène qui a aussi entraîné la chute des cours de l’huile de palme.
Le prix du porc, qui a connu «pendant quatre mois des cours d’un niveau constant et jamais atteint à 1,80 €/kg a connu un réajustement à 1,60 €/kg». Une conséquence «prévisible d’une réduction des achats chinois liée à la crise du coronavirus qui a fait baisser la consommation intérieure de porc». Un prix qui reste cependant rémunérateur «et chacun s’attend à sa remontée en cours d’année, ce qui maintiendrait les conditions de revenu des éleveurs à un niveau satisfaisant», assure Arnaud Delestre.
Encore «beaucoup de travail» sur les ZNT
Sujet fort de l’actualité agricole de ses derniers mois, le projet de loi ZNT a été abordé. Le 27 décembre dernier, a été publié «le décret relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytosanitaires à proximité des zones d’habitation, et l’arrêté relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques», lance Arnaud Delestre. «Au vu des nombreuses incertitudes subsistant quant à l’application de ces textes, un document établi par les ministères concernés a été transmis aux Préfets pour leur préciser les éléments de mise en œuvre».
Pour rappel, la réglementation fixe les distances d’éloignements à 20 m incompressibles pour les substances les plus préoccupantes dès le 1er janvier 2020. Pour les autres substances, elles sont de 10 m pour les cultures hautes (arboriculture et viticulture) et de 5 m pour les autres cultures. Ces distances pourront être réduites à 5 m en arboriculture et à 3 m en viticulture et autres cultures dans le cadre de chartes d’engagements, «à condition d’avoir recours à des moyens de réduction de la dérive». Ces distances s’appliqueront au 1er juillet 2020 pour les cultures emblavées au titre d’un cycle cultural à la date du 1er janvier 2020.
«Une imprécision demeure sur la définition de la zone non traitée et particulièrement son point de départ côté bâtiments d’habitation», reprend Arnaud Delestre. «Si les éléments de mise en œuvre précisent ce qu’est un bâtiment d’habitation à prendre en considération, en l’occurrence locaux affectés à l’habitation en sens large dès lors qu’ils sont régulièrement occupés ou fréquentés, ils précisent mal le point de départ du calcul de la distance».
Aussi, les conditions de réduction des distances ne sont pas finalisées. Des travaux sont toujours en cours pour déterminer si des barrières physiques comme des murs, haies ou filets permettent ces réductions. «Il reste beaucoup de travail à affiner pour que cette restriction soit valable et contrôlable».
Si ce dernier assure «qu’il est trop tôt pour prédire ce qu’il en sera réellement», il tient à rappeler que «la vendange icaunaise 2019 s’est avérée inférieure en volume à ce qui pouvait être attendu en début d’été, la sécheresse d’août ayant fortement impacté les rendements». La production 2019 a connu une baisse de 40% par rapport à 2018 et de 11% sur la moyenne des cinq dernières années.
En ce qui concerne le marché du vin icaunais à l’étranger, en particulier le Chablis, le Brexit et la taxe Trump pourraient avoir une influence importante. Pour le premier, «il est probable qu’un accord de libre-échange soit un jour négocié, ce qui fluidifierait les échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne et sécuriserait les ventes de Chablis», développe Arnaud Delestre. Quant au second, «une taxe de 25% est appliquée aux vins français en règlement d’un litige avec Airbus, jugé à l’OMC. Il semblerait que la filière commerciale s’adapte en rognant sur ses marges, si bien qu’actuellement, les volumes ne semblent pas significativement impactés», poursuit-il. Aussi, la taxe Trump pourrait être redéfinie dans son taux comme dans son étendue et concerner les vins effervescents, impactant ainsi les crémants.
Le coronavirus fragilise le contexte mondial
Plus tôt lors de la session, Arnaud Delestre a commencé par parler du contexte mondial. «Alors que l’économie fonctionne avec des perspectives de ralentissement auxquelles s’ajoutent en toile de fond la guerre commerciale sino-américaine et le Brexit, les échanges sont marqués au moins conjoncturellement par l’épidémie de coronavirus qui rejaillit sur les marchés agricoles, tant sur le porc que le colza. Ainsi, l’anticipation d’une épidémie a induit une baisse des cours du blé, traduisant en cela la crainte d’une baisse de la demande mondiale et notamment chinoise», continue le président de la Chambre d’agriculture de l’Yonne. «Le colza s’est replié, également et indirectement impacté par la crainte de l’épidémie de coronavirus qui a entraîné une chute des cours du soja dont l’huile est achetée en volume conséquent par la Chine». Un phénomène qui a aussi entraîné la chute des cours de l’huile de palme.
Le prix du porc, qui a connu «pendant quatre mois des cours d’un niveau constant et jamais atteint à 1,80 €/kg a connu un réajustement à 1,60 €/kg». Une conséquence «prévisible d’une réduction des achats chinois liée à la crise du coronavirus qui a fait baisser la consommation intérieure de porc». Un prix qui reste cependant rémunérateur «et chacun s’attend à sa remontée en cours d’année, ce qui maintiendrait les conditions de revenu des éleveurs à un niveau satisfaisant», assure Arnaud Delestre.
Encore «beaucoup de travail» sur les ZNT
Sujet fort de l’actualité agricole de ses derniers mois, le projet de loi ZNT a été abordé. Le 27 décembre dernier, a été publié «le décret relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytosanitaires à proximité des zones d’habitation, et l’arrêté relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques», lance Arnaud Delestre. «Au vu des nombreuses incertitudes subsistant quant à l’application de ces textes, un document établi par les ministères concernés a été transmis aux Préfets pour leur préciser les éléments de mise en œuvre».
Pour rappel, la réglementation fixe les distances d’éloignements à 20 m incompressibles pour les substances les plus préoccupantes dès le 1er janvier 2020. Pour les autres substances, elles sont de 10 m pour les cultures hautes (arboriculture et viticulture) et de 5 m pour les autres cultures. Ces distances pourront être réduites à 5 m en arboriculture et à 3 m en viticulture et autres cultures dans le cadre de chartes d’engagements, «à condition d’avoir recours à des moyens de réduction de la dérive». Ces distances s’appliqueront au 1er juillet 2020 pour les cultures emblavées au titre d’un cycle cultural à la date du 1er janvier 2020.
«Une imprécision demeure sur la définition de la zone non traitée et particulièrement son point de départ côté bâtiments d’habitation», reprend Arnaud Delestre. «Si les éléments de mise en œuvre précisent ce qu’est un bâtiment d’habitation à prendre en considération, en l’occurrence locaux affectés à l’habitation en sens large dès lors qu’ils sont régulièrement occupés ou fréquentés, ils précisent mal le point de départ du calcul de la distance».
Aussi, les conditions de réduction des distances ne sont pas finalisées. Des travaux sont toujours en cours pour déterminer si des barrières physiques comme des murs, haies ou filets permettent ces réductions. «Il reste beaucoup de travail à affiner pour que cette restriction soit valable et contrôlable».
La période de chasse prolongée
Alors que la période de chasse devait normalement se clôturer le 29 février, celle-ci a été prolongée jusqu’au 31 mars en vue de résorber l’importance des dégâts aux cultures. Aussi, «le Préfet a décidé d’une autorisation administrative de prélèvement de sangliers entre le 1er avril et le 31 mai 2020 sur les parcelles agricoles concernées par les dégâts», détaille Arnaud Delestre. Des tirs seront autorisés à l’affût et à l’approche sur une période journalière allant de deux heures avant le lever du soleil jusqu’à deux heures après son coucher. Des tirs à poste fixe au sol ou surélevé seront également autorisés de nuit avec source lumineuse si les tirs précédents se sont avérés inefficaces. Les tireurs doivent être détenteurs du droit de chasse et une autorisation individuelle spécifique doit être demandée à la DDT par le détenteur du droit de chasse ou à défaut par l’exploitant agricole.


