FDSEA 89
Un nouveau président à la tête de la section viticole
Régis Ségault, viticulteur à Maligny, est le nouveau président de la section viticole à la FDSEA de l’Yonne, succédant ainsi à Jean-Baptiste Thibaut. Parmi les chantiers en cours, les négociations entre bailleurs et preneurs concernant le remplacement des pieds touchés par l’esca
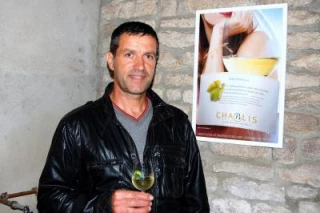
De son propre aveu, Régis Ségault se dit [I]«moins volubile que son prédécesseur»[i] et revendique une certaine discrétion, pour ne pas dire une discrétion certaine ! Élu au printemps dernier à la tête de la section viticole de la FDSEA de l’Yonne, ce viticulteur exploite en famille dans le chablisien 18 ha de vigne en AOC Chablis et Petit Chablis, commercialisés essentiellement par le biais de négociants, ainsi que 150 ha de céréales. Les travaux menés par la section viticole sont nombreux, au premier rang desquels l’urgence à réfléchir sur la prise en compte de l’esca dans l’arrêté départemental portant application du statut du fermage, avec cette double question : qui doit supporter le coût des replantations ? Qui réalise le travail ? A l’image des autres départements bourguignons, l’esca touche durement le vignoble icaunais alors même qu’il n’existe pas à ce jour de traitement pour lutter de manière pérenne contre la maladie, l’arsénite de sodium utilisé jusqu’alors ayant été interdit en France en 2001, jugé toxique et dangereux pour ses utilisateurs. Le seul moyen de contrer la maladie est d’arracher les pieds atteints en veillant, précise Régis Ségault, [I]«à stocker les bois morts, si on ne les brûle pas tout de suite, sous un hangar ou sous une bâche, afin d’éviter toute propagation de spores contaminants…»[i]
[INTER]Seuls les baux à venir seront concernés[inter]
Depuis plusieurs mois, un groupe de travail composé pour partie de preneurs et de l’autre, de bailleurs, se penche sur le problème et des premières pistes se dessinent, face au flou de certains baux, où il est écrit que [I]«la responsabilité de remplacer les pieds malades incombe aux preneurs»[i], en contradiction avec les textes du Code civil. Avec l’assurance pour le preneur d’avoir gain de cause face à son bailleur en cas de litige devant les Tribunaux Paritaires des Baux Ruraux. Il y a urgence à trouver un compromis car la recrudescence de la maladie multiplie les procédures judiciaires. Tout le mode est conscient de la réalité du problème et s’accorde à dire que la situation ne peut rester en l’état. Afin d’éclaircir la portée des négociations en cours, il a été décidé par les deux parties, que les nouvelles dispositions qui seront conclues et validées par la Commission Consultative des Baux Ruraux, incluses dans l’arrêté départemental à terme, ne s’appliqueront qu’aux baux à venir et non à ceux en cours. Elles auront néanmoins valeur de préconisation dans la résolution des conflits concernant des baux déjà en cours.
[INTER]Des discussions constructives[inter]
Les travaux entrepris lors des précédentes réunions sont organisés de façon à différencier les problèmes en fonction des situations : dans le premier cas, le propriétaire loue une parcelle de vignes plantées, restant ainsi propriétaire des droits de plantation à l’issue du bail, dans l’autre, en cas de terre nue et louée à planter, la charge des replantations étant différente. Pour l’heure, le groupe de travail s’est penché sur le premier cas de figure. Parallèlement, il a été décidé de solliciter par courrier adressé à la Chambre des Notaires, une rencontre avec les représentants qu’ils souhaiteront associer au travail sur ce dossier, afin de voir leur regard sur le problème et les pistes de solutions susceptibles d’être apportées. Il est d’autant plus urgent de déboucher sur un accord que cette année, on aura comptabilisé près de 15 % de pieds à remplacer suivant les endroits, mettant à mal la trésorerie de certaines exploitations, voire leur viabilité. Les vignes le plus touchées semblant avoir en moyenne de 15 à 20 ans d’âge.
Après deux réunions du groupe mixte bailleurs/preneurs les 26 mai et 1er juillet derniers, la section viticole de la FDSEA de l’Yonne se réunira le mardi 22 juillet à 17 h 30, avant une réunion commune en octobre après les vendanges. L’objectif final étant d’avoir suffisamment d’éléments à proposer à la prochaine Commission Consultative des Baux Ruraux du printemps prochain. Un point positif toutefois : l’état d’esprit dans lequel se déroulent les discussions, jugé par tous comme constructif.
[INTER]Seuls les baux à venir seront concernés[inter]
Depuis plusieurs mois, un groupe de travail composé pour partie de preneurs et de l’autre, de bailleurs, se penche sur le problème et des premières pistes se dessinent, face au flou de certains baux, où il est écrit que [I]«la responsabilité de remplacer les pieds malades incombe aux preneurs»[i], en contradiction avec les textes du Code civil. Avec l’assurance pour le preneur d’avoir gain de cause face à son bailleur en cas de litige devant les Tribunaux Paritaires des Baux Ruraux. Il y a urgence à trouver un compromis car la recrudescence de la maladie multiplie les procédures judiciaires. Tout le mode est conscient de la réalité du problème et s’accorde à dire que la situation ne peut rester en l’état. Afin d’éclaircir la portée des négociations en cours, il a été décidé par les deux parties, que les nouvelles dispositions qui seront conclues et validées par la Commission Consultative des Baux Ruraux, incluses dans l’arrêté départemental à terme, ne s’appliqueront qu’aux baux à venir et non à ceux en cours. Elles auront néanmoins valeur de préconisation dans la résolution des conflits concernant des baux déjà en cours.
[INTER]Des discussions constructives[inter]
Les travaux entrepris lors des précédentes réunions sont organisés de façon à différencier les problèmes en fonction des situations : dans le premier cas, le propriétaire loue une parcelle de vignes plantées, restant ainsi propriétaire des droits de plantation à l’issue du bail, dans l’autre, en cas de terre nue et louée à planter, la charge des replantations étant différente. Pour l’heure, le groupe de travail s’est penché sur le premier cas de figure. Parallèlement, il a été décidé de solliciter par courrier adressé à la Chambre des Notaires, une rencontre avec les représentants qu’ils souhaiteront associer au travail sur ce dossier, afin de voir leur regard sur le problème et les pistes de solutions susceptibles d’être apportées. Il est d’autant plus urgent de déboucher sur un accord que cette année, on aura comptabilisé près de 15 % de pieds à remplacer suivant les endroits, mettant à mal la trésorerie de certaines exploitations, voire leur viabilité. Les vignes le plus touchées semblant avoir en moyenne de 15 à 20 ans d’âge.
Après deux réunions du groupe mixte bailleurs/preneurs les 26 mai et 1er juillet derniers, la section viticole de la FDSEA de l’Yonne se réunira le mardi 22 juillet à 17 h 30, avant une réunion commune en octobre après les vendanges. L’objectif final étant d’avoir suffisamment d’éléments à proposer à la prochaine Commission Consultative des Baux Ruraux du printemps prochain. Un point positif toutefois : l’état d’esprit dans lequel se déroulent les discussions, jugé par tous comme constructif.
L’Esca : une maladie ancienne
L’esca est une des plus anciennes maladies de la vigne, les Romains ayant déjà remarqué sa présence sur les ceps de l’époque. C’est une maladie due à des champignons parasites, dont la complexité rend les rôles respectifs des différents agents mal connus à ce jour. La dissémination des spores s’effectue par pénétration des plaies de la taille, humides et récentes (notamment lors de périodes hivernales douces et pluvieuses). A l’intérieur du cep, les champignons désorganisent les cellules, détruisant le bois en tuant d’abord les parties imprégnées puis par le développement d’un mycélium à l’intérieur du bois mort, qui détruit lignine. Le bois devient alors mou et friable, formant un tissu spongieux et jaunâtre comparable à de l’amadou. Les conditions favorables à sa propagation sont multiples : la chaleur (ce qui explique l’importance de la maladie en zone méditerranéenne), l’humidité (elle doit être supérieure à 60 % et fournie par le bois vivant, à côté du bois mort) ou encore l’absence d’oxygène, les champignons vecteurs de la maladie étant anaérobies.


