Crise sanitaire
Confinement : c’était il y a un an déjà
Le 16 mars 2020, le Président de la République, Emmanuel Macron, annonçait un confinement national, effectif dès le lendemain. La France s’est alors figée. Les commerces et bon nombre d’entreprises ont fermé, le télétravail était de mise et les sorties étaient autorisées uniquement pour motif impérieux, sur attestation dérogatoire. Tous les secteurs, sans exceptions, ont été impactés. L’agriculture n’a pas été épargnée. L’élevage, la viticulture, l’horticulture… Le travail de beaucoup d’agriculteurs en a pâti. Et certains en pâtissent encore aujourd’hui.
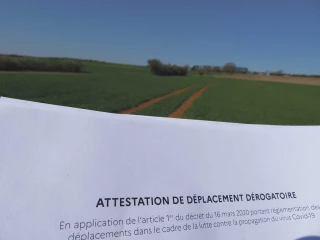
Il y a exactement un an et dix jours, le quotidien des Français s’apprêtait à basculer dans un autre monde, un monde où tout s’est arrêté. Le 16 mars 2020, le Président de la République, Emmanuel Macron, prend la parole et annonce, dans un discours retransmis à la télévision, un confinement national pour une période initiale de quinze jours, effectif dès le lendemain. La France se fige, à l’image du monde entier où certains pays avaient déjà pris quelque temps auparavant, la décision de confiner leurs populations. Mais il y a un an, nous étions tous très loin d’imaginer ce qui nous attendait. Nous étions encore plus loin d’imaginer que nous serions toujours dans une situation similaire aujourd’hui, avec 16 départements à nouveau confinés (pour la troisième fois), depuis le 19 mars. Et cela semble loin d’être fini.
Quelques jours après l’annonce de ce qui est aujourd’hui le « premier » confinement, le Premier ministre de l’époque, Édouard Philippe, annonce la fermeture temporaire de tous les marchés de France. Ce dernier laisse toutefois la possibilité aux Préfets de déroger à cette mesure (sous condition que les marchés alimentaires répondent à un besoin d’approvisionnement de la population n’ayant pas accès dans un secteur proche à d’autres sources d’approvisionnement). Cependant, le Préfet de l’Yonne, Henri Prévost, refuse, dans un premier temps, la quasi-totalité des demandes de dérogation. Mais, au vu du parfait respect des règles sanitaires par les producteurs, le Préfet autorise rapidement la réouverture d’un certain nombre de marchés. « La volonté était de permettre l’approvisionnement des habitants. Le Gouvernement a toujours été très vigilant à ce qu’il n’y ait pas de restriction aux denrées alimentaires essentielles. On a travaillé, au niveau national, avec les professions qui organisent les marchés, pour que ces derniers soient organisés dans des conditions très sécurisés », indiquait-il en avril 2020.
Des annulations en pagaille pour Pâques, en 2020
La filière élevage fait partie des secteurs les plus impactés par cette crise sanitaire. En 2020, quelques jours avant Pâques, les éleveurs ovins enchaînaient les annulations de commande, suite à l’interdiction de se réunir pour les traditionnels repas de famille. « Il y a 80 % d’annulation en moyenne. Cela va être très compliqué pour nous », s’inquiétait Frédéric Fernandes, éleveur à Vault-de-Lugny. Les prix chutaient également, passant de 7 euros le kilo à un peu plus de 5 euros.
Alors, qu’en est-il aujourd’hui ? « Cette année, cela va mieux. Les courts sont soutenus en conventionnel comme en bio. Le prix du kilo est remonté à 7,30 euros », confie Frédéric Fernandes. « J’ai des commandes et aucune annulation pour le moment. Sauf annonce catastrophique par le Gouvernement, cela ira mieux cette année pour la filière ».
Pour autant, « ce n’est pas l’euphorie non plus », assure-t-il. « On essaye d’absorber les pertes. J’ai perdu 20 000 euros l’an dernier ».
A contrario, la filière bovine, déjà en difficulté à l’époque, ne va pas mieux. « Les marchés sont bloqués, avec des courts très bas. La fermeture des restaurants n’aide pas. On espère qu’ils pourront rouvrir rapidement. Cela ira beaucoup mieux pour tout le monde ». Pour les restaurateurs, les éleveurs, mais aussi pour les consommateurs.
Le « deux poids, deux mesures » pour les viticulteurs
Les semaines passent et le confinement se prolonge sur le territoire Français. Beaucoup luttent pour leur survie. C’est de cas des viticulteurs. Délaissés par les consommateurs avec la fermeture des caveaux, beaucoup oublient que le vin fait partie de la liste des achats de première nécessité, qu’il est possible d’aller acheter grâce à son attestation. La perte du chiffre d’affaires de la filière viticole, provenant de la vente directe, est alors importante avec une baisse de 15 % (selon les chiffres du BIVB). Sans compter celles dues aux annulations des salons et foires. « Cela représente environ 20 % de perte sur notre chiffre d’affaires », évoquait Laurent Ternynck, viticulteur à Préhy, en octobre dernier. Des pertes financières, mais aussi de visibilité et de prestige. Avec l’annulation du Salon international de l’agriculture, c’est une belle vitrine qui s’envole pour tous les producteurs de vin et d’autres denrées.
Stéphanie Futaully, viticultrice à Beine, regrettait, quant à elle, le « deux poids, deux mesures » du Gouvernement. « Je ne comprends pas pourquoi nous interdisons aux gens d’aller dans un salon des vins, ou certains marchés, acheter un carton de vin, alors que nous les autorisons à le faire au supermarché ? Et cela sans limiter les entrées, du moment qu’ils aient un masque ». Car pour les producteurs ne fonctionnant pas avec la grande distribution, les pertes ont été (et sont encore aujourd’hui pour certains) énormes.
Des milliers de fleurs forcées d’être jetées
L’agriculture, ce n’est pas seulement l’alimentation. C’est aussi la production de fleurs, entre autres. Et contrairement à beaucoup de leurs collègues agriculteurs, les horticulteurs ont dû fermer boutique pendant le confinement, ne faisant pas parti des commerces dits « essentiels ». Alors, indéniablement, il y a eu des pertes. « J’ai jeté 40 000 Pensées, soit plus de la moitié de ma production, et plus de 10 000 Primevères », s’indignait Stéphane Peuraud, horticulteur à Lindry. « Dans notre métier, mars, avril et mai représentent environ 70 % de notre chiffre d’affaires annuel ».
Lors du « second » confinement, entre octobre et novembre, les horticulteurs ont à nouveau dû fermer. « Dans l’horticulture, il y a deux grosses saisons : le printemps et la Toussaint », expliquait Johann Rigout, gérant des Serres de Champs Galottes à Saint-Bris-le-Vineux, qui a connu une perte au niveau de ses ventes, d’environ 10 à 15 %, à la Toussaint. Des pertes accentuées en novembre avec de nombreuses plantes jetées.
Encore une fois, c’est l’inégalité entre les producteurs qui ressort. Là où les horticulteurs ont dû faire portes closes, les jardineries et grandes surfaces pouvaient continuer de vendre des fleurs. Une concurrence « déloyale » dénoncée par la profession, qui ne les a pas aidés dans un moment si délicat.
Heureusement, tous ont pu rouvrir, mais pour combien de temps ? La situation est encore très loin d’être résolue en France, tant sur le plan sanitaire que sur le plan économique. Et l’ombre d’un nouveau confinement national planera de plus en plus, si le seuil ne baisse pas rapidement. Cela fait déjà un an que le « premier » confinement a été prononcé. La suite, nous la connaissons tous…
Quelques jours après l’annonce de ce qui est aujourd’hui le « premier » confinement, le Premier ministre de l’époque, Édouard Philippe, annonce la fermeture temporaire de tous les marchés de France. Ce dernier laisse toutefois la possibilité aux Préfets de déroger à cette mesure (sous condition que les marchés alimentaires répondent à un besoin d’approvisionnement de la population n’ayant pas accès dans un secteur proche à d’autres sources d’approvisionnement). Cependant, le Préfet de l’Yonne, Henri Prévost, refuse, dans un premier temps, la quasi-totalité des demandes de dérogation. Mais, au vu du parfait respect des règles sanitaires par les producteurs, le Préfet autorise rapidement la réouverture d’un certain nombre de marchés. « La volonté était de permettre l’approvisionnement des habitants. Le Gouvernement a toujours été très vigilant à ce qu’il n’y ait pas de restriction aux denrées alimentaires essentielles. On a travaillé, au niveau national, avec les professions qui organisent les marchés, pour que ces derniers soient organisés dans des conditions très sécurisés », indiquait-il en avril 2020.
Des annulations en pagaille pour Pâques, en 2020
La filière élevage fait partie des secteurs les plus impactés par cette crise sanitaire. En 2020, quelques jours avant Pâques, les éleveurs ovins enchaînaient les annulations de commande, suite à l’interdiction de se réunir pour les traditionnels repas de famille. « Il y a 80 % d’annulation en moyenne. Cela va être très compliqué pour nous », s’inquiétait Frédéric Fernandes, éleveur à Vault-de-Lugny. Les prix chutaient également, passant de 7 euros le kilo à un peu plus de 5 euros.
Alors, qu’en est-il aujourd’hui ? « Cette année, cela va mieux. Les courts sont soutenus en conventionnel comme en bio. Le prix du kilo est remonté à 7,30 euros », confie Frédéric Fernandes. « J’ai des commandes et aucune annulation pour le moment. Sauf annonce catastrophique par le Gouvernement, cela ira mieux cette année pour la filière ».
Pour autant, « ce n’est pas l’euphorie non plus », assure-t-il. « On essaye d’absorber les pertes. J’ai perdu 20 000 euros l’an dernier ».
A contrario, la filière bovine, déjà en difficulté à l’époque, ne va pas mieux. « Les marchés sont bloqués, avec des courts très bas. La fermeture des restaurants n’aide pas. On espère qu’ils pourront rouvrir rapidement. Cela ira beaucoup mieux pour tout le monde ». Pour les restaurateurs, les éleveurs, mais aussi pour les consommateurs.
Le « deux poids, deux mesures » pour les viticulteurs
Les semaines passent et le confinement se prolonge sur le territoire Français. Beaucoup luttent pour leur survie. C’est de cas des viticulteurs. Délaissés par les consommateurs avec la fermeture des caveaux, beaucoup oublient que le vin fait partie de la liste des achats de première nécessité, qu’il est possible d’aller acheter grâce à son attestation. La perte du chiffre d’affaires de la filière viticole, provenant de la vente directe, est alors importante avec une baisse de 15 % (selon les chiffres du BIVB). Sans compter celles dues aux annulations des salons et foires. « Cela représente environ 20 % de perte sur notre chiffre d’affaires », évoquait Laurent Ternynck, viticulteur à Préhy, en octobre dernier. Des pertes financières, mais aussi de visibilité et de prestige. Avec l’annulation du Salon international de l’agriculture, c’est une belle vitrine qui s’envole pour tous les producteurs de vin et d’autres denrées.
Stéphanie Futaully, viticultrice à Beine, regrettait, quant à elle, le « deux poids, deux mesures » du Gouvernement. « Je ne comprends pas pourquoi nous interdisons aux gens d’aller dans un salon des vins, ou certains marchés, acheter un carton de vin, alors que nous les autorisons à le faire au supermarché ? Et cela sans limiter les entrées, du moment qu’ils aient un masque ». Car pour les producteurs ne fonctionnant pas avec la grande distribution, les pertes ont été (et sont encore aujourd’hui pour certains) énormes.
Des milliers de fleurs forcées d’être jetées
L’agriculture, ce n’est pas seulement l’alimentation. C’est aussi la production de fleurs, entre autres. Et contrairement à beaucoup de leurs collègues agriculteurs, les horticulteurs ont dû fermer boutique pendant le confinement, ne faisant pas parti des commerces dits « essentiels ». Alors, indéniablement, il y a eu des pertes. « J’ai jeté 40 000 Pensées, soit plus de la moitié de ma production, et plus de 10 000 Primevères », s’indignait Stéphane Peuraud, horticulteur à Lindry. « Dans notre métier, mars, avril et mai représentent environ 70 % de notre chiffre d’affaires annuel ».
Lors du « second » confinement, entre octobre et novembre, les horticulteurs ont à nouveau dû fermer. « Dans l’horticulture, il y a deux grosses saisons : le printemps et la Toussaint », expliquait Johann Rigout, gérant des Serres de Champs Galottes à Saint-Bris-le-Vineux, qui a connu une perte au niveau de ses ventes, d’environ 10 à 15 %, à la Toussaint. Des pertes accentuées en novembre avec de nombreuses plantes jetées.
Encore une fois, c’est l’inégalité entre les producteurs qui ressort. Là où les horticulteurs ont dû faire portes closes, les jardineries et grandes surfaces pouvaient continuer de vendre des fleurs. Une concurrence « déloyale » dénoncée par la profession, qui ne les a pas aidés dans un moment si délicat.
Heureusement, tous ont pu rouvrir, mais pour combien de temps ? La situation est encore très loin d’être résolue en France, tant sur le plan sanitaire que sur le plan économique. Et l’ombre d’un nouveau confinement national planera de plus en plus, si le seuil ne baisse pas rapidement. Cela fait déjà un an que le « premier » confinement a été prononcé. La suite, nous la connaissons tous…
L’explosion des drives fermiers
Durant le confinement du printemps 2020, la vente de produit locaux en circuit court a attiré un grand nombre de nouveaux clients. Avec les restrictions de sorties, les commandes en ligne ont augmenté. Au point de voir le chiffre d’affaires des drives fermiers être multiplié par trois durant cette période. « Pour le drive de Sens, on a atteint les 200 commandes par semaine, contre une quarantaine habituellement », analysait à cette époque Alice Demolder-Bilhot, conseillère à la Chambre d’agriculture de l’Yonne. Une tendance similaire sur les autres drives du département (à Auxerre et Avallon), mais aussi sur l’ensemble de la France.
Alors, pourquoi ? « Les produits locaux sont encore plus mis en avant en cette période. Il y a une sorte de solidarité qui émerge chez le consommateur pour le producteur. Certains sont sensibilisés à cela », répondait Alice Demolder-Bilhot.
Un an après, où en sommes-nous ? Sur ce début d’année 2021, les drives de Sens et Avallon ont retrouvé le rythme « d’avant » (25 commandes par semaine en moyenne pour Avallon). Tandis que celui d’Auxerre a conservé sa montée en puissance. « Il est en moyenne à 150 paniers par semaine, soit près de 50 paniers de plus par rapport à ce qu’il faisait avant », assure Alice Demolder-Bilhot.
Alors, pourquoi ? « Les produits locaux sont encore plus mis en avant en cette période. Il y a une sorte de solidarité qui émerge chez le consommateur pour le producteur. Certains sont sensibilisés à cela », répondait Alice Demolder-Bilhot.
Un an après, où en sommes-nous ? Sur ce début d’année 2021, les drives de Sens et Avallon ont retrouvé le rythme « d’avant » (25 commandes par semaine en moyenne pour Avallon). Tandis que celui d’Auxerre a conservé sa montée en puissance. « Il est en moyenne à 150 paniers par semaine, soit près de 50 paniers de plus par rapport à ce qu’il faisait avant », assure Alice Demolder-Bilhot.


